
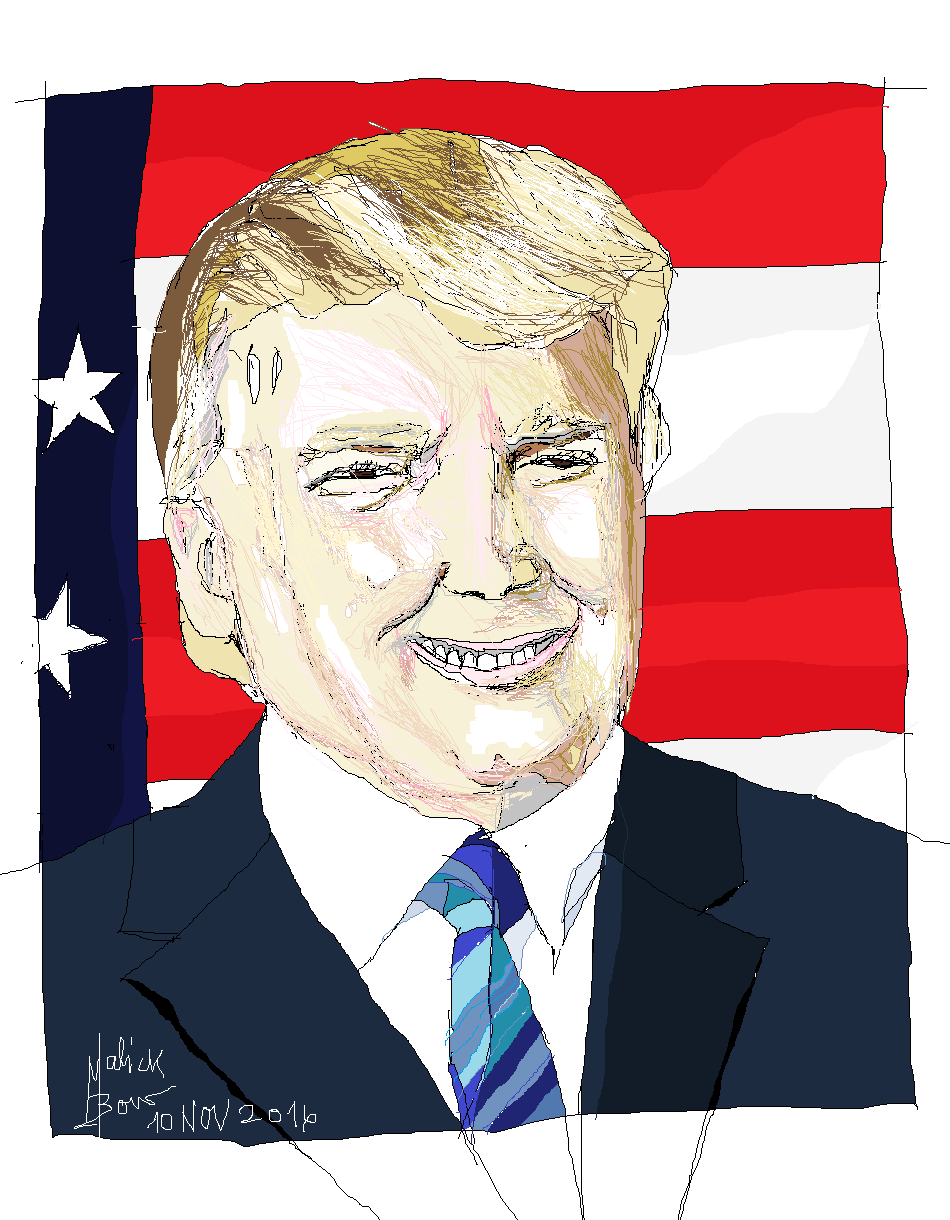
Stéphane François — 06.03.2017 – 7 h 11, mis à jour le 06.03.2017 à 8 h 38
La critique de la politique et du mode de vie américains a souvent servi de support à une autre critique, plus radicale, de la modernité.
L’écriture de la Déclaration d’indépendance par Benjamin Franklin, John Adams et Thomas Jefferson, par Jean Leon Gerome Ferris (1900). Via Wikimédia Commons.
L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et sa pratique pour le moins particulière de sa fonction de président seront bientôt des prétextes pour certains intellectuels et militants au rejet, plus global et classique, des États-Unis. En effet, celui-ci est une vieille antienne des extrémistes européens, tant de gauche que de droite, qui rejettent à la fois la «République impériale», pour reprendre l’expression de Raymond Aron, et son mode de vie, le fameux american way of life. Surtout, derrière ce rejet, nous pouvons voir une autre critique, plus radicale, de la modernité issue des Lumières.
Cette critique, la modernité devant être comprise à la fois comme l’expression de l’exception occidentale de civilisation, comme celle du libéralisme (politique et économique) et enfin comme celle de la manifestation du progrès (l’«idéologie du progrès»), est devenue fréquente, tant à l’extrême gauche qu’à l’extrême droite.
Elle s’élève de nos jours même de toutes parts: les écologistes remettent en cause le productivisme depuis le milieu des années 1970; les postmodernes veulent en finir avec les «grands récits» de légitimation historicistes; les communautaristes affirment que le modèle libéral pousse les individus à s’éloigner les uns des autres; l’extrême droite voient dans la modernité une expression de la décadence. Nous pourrions multiplier indéfiniment les exemples. Toutefois, nous ne nous intéresserons ici qu’aux critiques émanant des franges radicales antimondialistes de l’extrême gauche et de l’extrême droite, qui associent refus de la modernité et rejet de l’Amérique.
Antiprogressisme et anti-occidentalisme
Ce rejet de l’idéologie du progrès est concomitant du rejet de la modernité libérale, tant politique et économique que philosophique. L’avènement de cette dernière n’a été pas, comme le souhaitaient les philosophes des Lumières, une ascension linéaire, heureuse, facile sur tous les plans. Bien au contraire: elle a produit dans un premier temps presque autant de désorientation et de souffrance, avec la perte des repères de vie traditionnelle, que d’espoir et d’enrichissement, notamment par l’émancipation de l’individu aux règles contraignantes de ces sociétés traditionnelles. Cette critique est couplée, dans les discours qui nous intéressent, à celle d’autres concepts nés eux-aussi des Lumières, ou qui lui sont proches: le progrès, le libéralisme, le matérialisme, l’économicisme (le «tout économique»), l’individualisme et comme le règne de l’uniformisation et de la massification des pratiques sociales et des habitus de consommation.
Pour les plus radicaux de ses contempteurs, le libéralisme est vu, et doit être vu, comme une maladie dégénérative du monde moderne. Ces personnes inversent la proposition classique, progressiste: le passé n’est plus inférieur au présent et à l’avenir, mais au contraire supérieur à ceux-ci. Dès lors, la modernité devient dans ces argumentaires une sorte de monstre protéiforme d’où proviennent tous nos maux, dont les États-Unis seraient les principaux propagateurs. Cet argumentaire pour le moins conservateur se retrouve aujourd’hui de l’extrême droite à une extrême gauche conservatrice fort en vogue aujourd’hui.
Cette convergence intellectuelle se fait au nom d’un combat contre les «antivaleurs» occidentales (à comprendre implicitement comme un combat contre l’impérialisme culturel, politique et économique américain), entre une certaine droite radicale non-conformiste, communautarienne, antitotalitaire et organique et une gauche tout aussi radicale, non marxiste, ou postmarxiste, alternative, libertaire et communautariste. Les deux convergent dans le même rejet de l’idéologie démocratique-capitaliste, dans lequel le progrès promet biens et bien être terrestres. Ils refusent le dynamisme optimiste qui lui est propre et condamnent les valeurs qu’elle porte en son sein: l’émancipation individuelle, la sécularisation générale des valeurs, la liberté de penser…
Gauche et droite, et inversement
Ces milieux développent donc une radicalité idéologique antimoderne et antihumaniste, condamnant la perte des «valeurs». S’ils sont sensés être éloignés et s’opposer sur le plan idéologique, ils possèdent des lieux de convergence aux marges, contagieuses et créatrices de porosités doctrinales.
L’anti-américanisme, l’«américanophobie», en est un. Au-delà de la critique de l’«impérialisme» américain, il est l’expression d’une nostalgie d’une société close refermée sur elle-même: ces discours américanophobes font l’éloge du conservatisme, de l’enracinement, transcendant les clivages politiques. Ces milieux sont hostiles au matérialisme, au capitalisme, à l’uniformisation du monde et à la mondialisation, qui s’incarneraient selon eux dans le modèle américain. Celui-ci viserait à universaliser le primat absolu de la société marchande et de l’égalitarisme individualiste. Certains, dans les milieux de gauche de l’après-guerre, mais cela va être aussi postulé par une frange de la droite radicale, iront même jusqu’à affirmer que la diffusion de l’American way of life est une conquête culturelle délibérée: en imposant leur culture, les États-Unis imposent implicitement leur vision du monde, et donc leur civilisation consumériste.
Ils présentent aussi le libéralisme comme une idéologie reposant exclusivement sur la liberté, qu’elle soit économique ou politique, une liberté qui mettrait en péril les modèles holistes et organiques des sociétés traditionnelles, oubliant, volontairement les acquis comme les libertés de penser et de croire. A contrario, ces milieux antilibéraux et antimondialistes promeuvent une sorte de «conservatisme des valeurs», spiritualiste, qui se manifeste par le régionalisme, l’enracinement, l’éloge des différences, contre la «macdonaldisation» du monde, voire contre la «coca-colanisation» de celui. Cette vision du monde se manifeste surtout à l’extrême gauche chez les décroissants, les antimondialistes et chez les localistes, et à l’extrême droite au sein de la nébuleuse néo-droitière et de la mouvance identitaire.
Un combat anti-impérialiste
Dans l’expression «combat anti-impérialiste», «impérialisme» est à prendre ici dans le sens de l’impérialisme américain se présentant comme le «pays du Bien» et de la «guerre juste». Ces personnes condamnent la tendance qu’ont les États-Unis de se présenter comme une Nation élue, à mettre en avant leur destinée manifeste, cherchant à guider le monde sur le chemin du Bien.
Ces points de rapprochement idéologique, parfois concrétisés par des rapprochements de personnes, ont été facilités par la dernière guerre contre l’Irak, et la mise sous contrôle américain du pétrole irakien. En effet, les différents milieux radicaux étudiés voient dans la guerre en Irak, non pas une volonté de libérer le pays du dictateur Saddam Hussein, mais une volonté délibérée d’impérialisme politique et économique. Selon eux, le 11 septembre 2001, fut providentiel: les attentats offrirent un prétexte à l’application de cette politique étrangère. Ce combat se confond donc aussi avec celui contre le néocolonialisme occidental, une antienne de l’extrême gauche depuis plus de soixante ans, et un nouveau cheval de bataille pour l’extrême droite anti-américaine depuis le milieu des années 1970.
Cette idée est renforcée par le fait que les néoconservateurs américains ont écrit et répété que les États-Unis, jouissant d’une puissance sans pareil, doivent user et abuser sans complexe de leur force pour réorganiser le monde à leur guise, seuls ou avec des coalitions de circonstances.
Ce refus de l’hégémonie américaine se manifeste aussi par un rejet des droits de l’homme. Ces milieux ont élaboré une critique originale des droits de l’homme, afférente à leur refus de l’Amérique. Elle est née du rejet de ceux-ci conceptualisés par les gauches radicales des années 1970. Cette contestation de la valeur des droits de l’homme est en outre perçue comme un instrument de domination de l’Occident blanc, mais surtout des États-Unis, sur les différents peuples…
Les milieux étudiés constatent enfin l’extrême fragilité de ses fondements. De fait, les droits de l’homme sont liés à la fois à une reconnaissance de l’individu en tant qu’entité autonome et à l’universalisme uniformisateur, qui s’impose de façon hégémonique, indépendamment de la culture, de l’histoire et du contexte dans lequel il s’impose. C’est ce côté abstrait de l’universalisme qui est violemment critiqué.
Les droits de l’homme vont aussi à l’encontre d’un monde multipolaire. L’idéologie des droits de l’homme, universaliste, ne serait qu’un facteur d’acculturation et de domination, l’Occident s’érigeant en juge moral du genre humain. Dans les années 1970, les droits de l’homme ont été utilisés comme une arme contre le bloc soviétique. À la suite de la chute du Mur, en 1989, les droits de l’homme ont été utilisés contre les États qui s’opposent à la volonté messianique et hégémonique des États-Unis. Nos milieux, approfondissant cette analyse, concluent que l’utilisation des droits de l’homme par l’Occident n’est qu’un moyen d’affirmer sa supériorité sur le reste du monde, et donc sur les sociétés non occidentales.
Il existe donc une convergence intellectuelle entre une droite radicale non-conformiste et une gauche non marxiste, ou postmarxiste, alternative, tout aussi radicale. En effet, il y a des similitudes troublantes entre les contre-cultures post-Mai 68 et des éléments venus de la droite radicale: les antimodernes de droite et certains membres des contre-cultures issues de Mai 68 ont développé une critique similaire de la modernité occidentale. Cette similitude est liée à un effet de génération. Elle a aussi été facilitée par un jeu de références intellectuelles commun. Mais surtout, les discours étudiés dans cet article relève d’une vision pessimiste et nostalgique du monde dans lequel l’«américanophobie» joue le rôle important de structurant.
